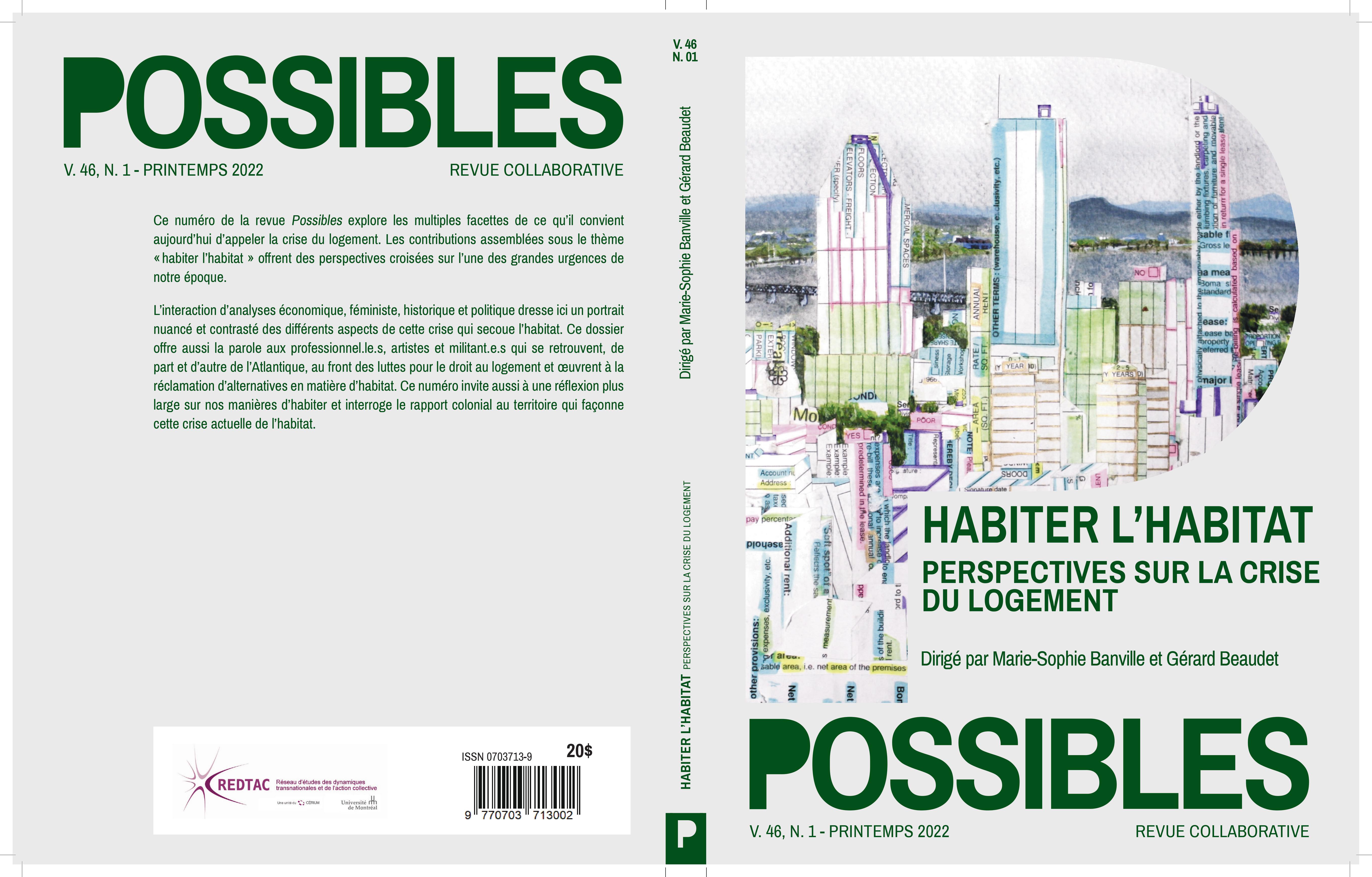Références
Carney, Mark. 2021. Value(s). Building a Better World for All. États-Unis : Signal.
Gaudreau, Louis et al. 2020. « L’immobilier, moteur de la ville néolibérale : Promotion résidentielle et production urbaine à Montréal », Collectif de recherche et d’action sur l’habitat.
Hill, Dan. 2012. Dark Matter and Trojan Horses. A Strategic Design Vocabulary. Moscou : Strelka Press.
Hilton, Carol Anne. 2021. Indigenomics. Gabriola Island: New Society Publishers.
Rakopoulos, Theodoros et Knut Rio. 2018. « Introduction to an Anthropology of Wealth », History and Anthropology 29(3): 275-291.
Statista Research Department. 2021. « Distribution of gross domestic product of Quebec, Canada in 2020, by industry » Statista. 4 octobre. En ligne : https://www.statista.com/statistics/607887/gdp-distribution-of-quebec-canada-by-industry/. (Page consultée le 18 février 2022).
Sterman, John D. 2002. « All models are wrong: reflections on becoming a systems scientist », System Dynamics Review 18(4): 513.
Stokes, Deborah. 2021 « Canada’s unhinged housing market, captured in one chart » The National Post. 12 novembre. En ligne : https://nationalpost.com/news/canada/canadas-unhinged-housing-market-captured-in-one-chart (Page consultée le 10 mars 2022).
Ville de Montréal. 2021. « Budget 2022 et PDI 2022-2031 de Montréal ». En ligne : https://montreal.ca/articles/budget-2022-et-pdi-2022-2031-de-montreal-24778. (Page consultée le 15 février 2022).
Willis, Anne Marie. 2006 « Ontological designing – laying the ground », Design Philosophy Papers. En ligne : https://www.academia.edu/888457/Ontological_designing (Page consultée le 2 avril 2022).