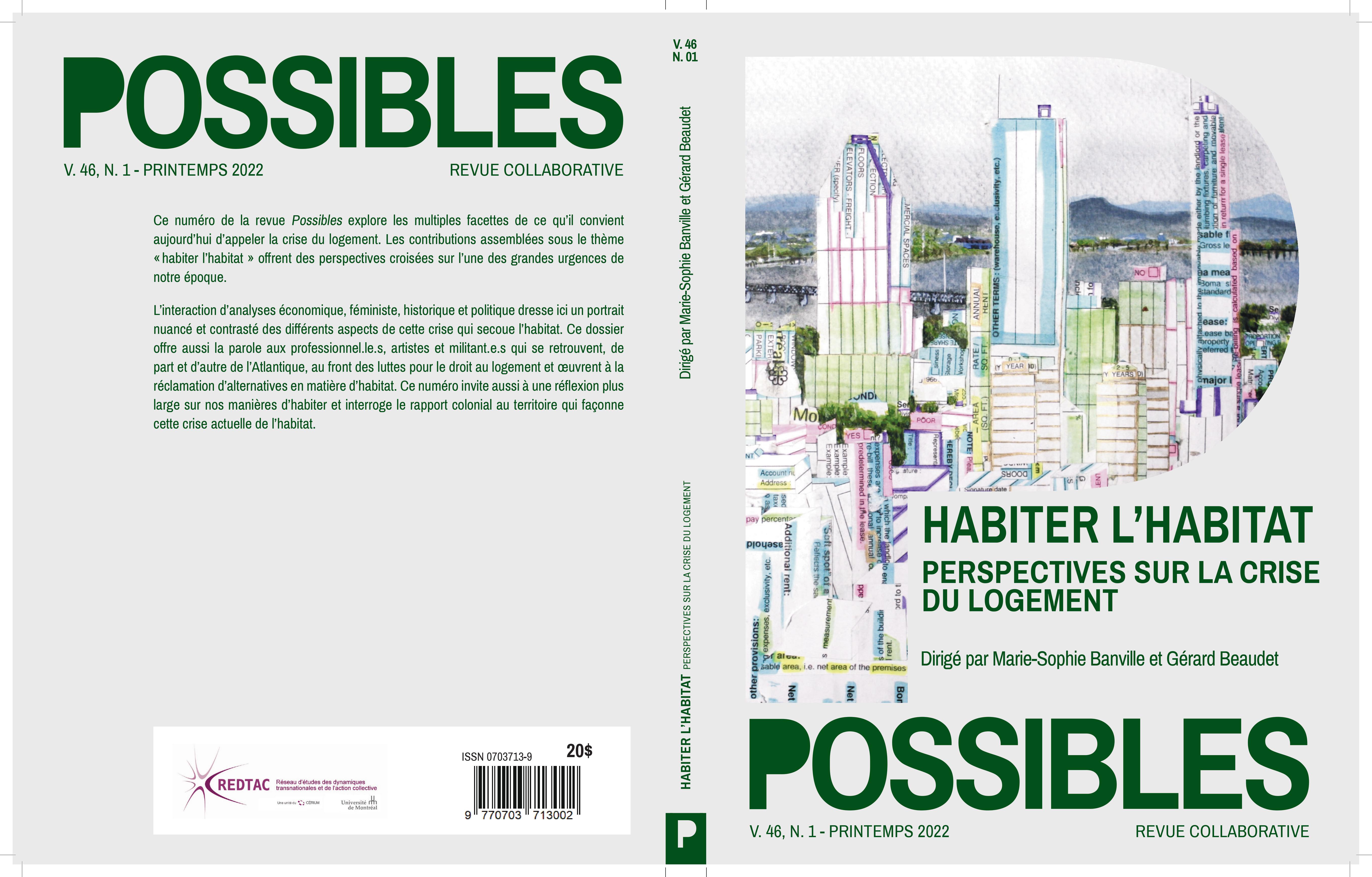Références
Ames, Herbert Brown. 1897/1987. The City Below the Hill: A Sociological Study of a Portion of Montreal. Toronto : University of Toronto Press.
Collin, Jean-Pierre. 1986. La cité coopérative canadienne-française, St-Léonard-de-Port-Maurice, 1955-1963. Québec : INRS-Urbanisation / Presses de l’Université du Québec.
Ducas, Isabelle. 2021. « Québec promet 2 milliards pour rénover des HLM vétustes », La Presse, 22 novembre.
Gaudreau, Louis, Guillaume Hébert et Julia Posca. 2020. Analyse du marché de l’immobilier et de la rentabilité du logement locatif. Note socio-économique, Institut de recherche et d’informations socio-économiques, 20 p.
Hannley, Lynn. 1994. « Les habitations de mauvaise qualité », dans Miron, John, R. (Dir.), Habitation et milieu de vie. Évolution du logement au Canada, 1945 à à 1986, pp. 229-247. Montréal / Ottawa : Mc Gill-Queen’s University Press.
Harris, Richard. 2004. Creeping Conformity: How Canada Became Suburban, 1900-1960. Toronto : University of Toronto Press.
Holdsworth, Deryck et Joan Simon. 1994. « Les formes d’habitation et l’utilisation de l’espace intérieur », dans : Miron, John R. (Dir.), Habitation et milieu de vie. Évolution du logement au Canada, 1945 à 1986, pp. 212-228. Montréal / Ottawa : Mc Gill-Queen’s University Press.