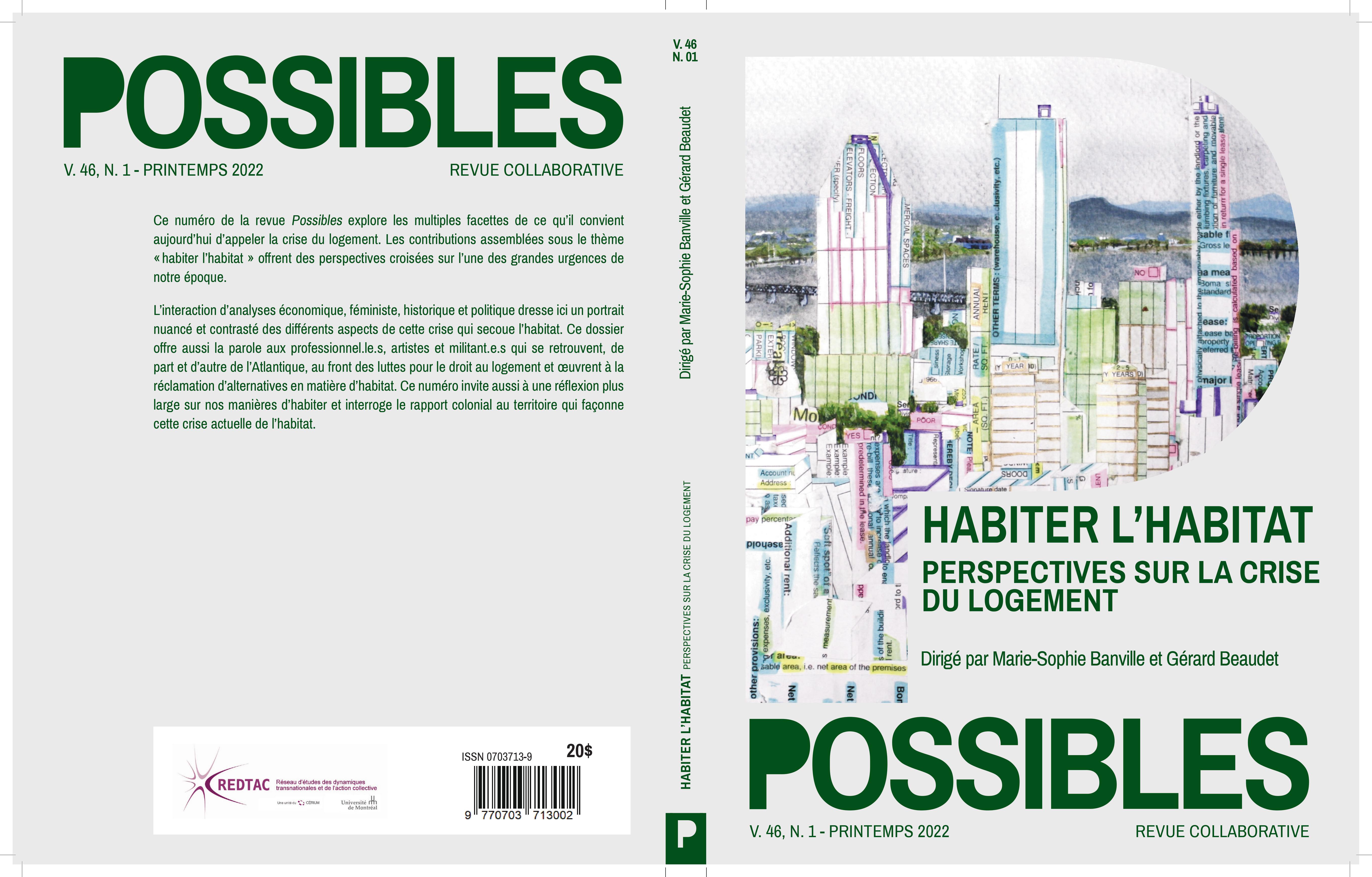Comment citer
Beaudet, G. (2022) « Offrir un toit aux plus démunis: chronique de la production du logement social », Revue Possibles, 46(1), p. 31–41. doi: 10.62212/revuepossibles.v46i1.471.
ACM
ACS
APA (en)
APA (fr)
ABNT
Chicago (en)
Chicago (fr)
Harvard
IEEE
MLA
Turabian
Vancouver
Télécharger la référence
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS) BibTeXArticles les plus lus du,de la,des même-s auteur-e-s
- Marie-Sophie Banville, Gérard Beaudet, L'habitat à l'épreuve de l'habiter , Revue Possibles: Vol. 46 No. 1 (2022): Habiter l'habitat. Perspectives sur la crise du logement