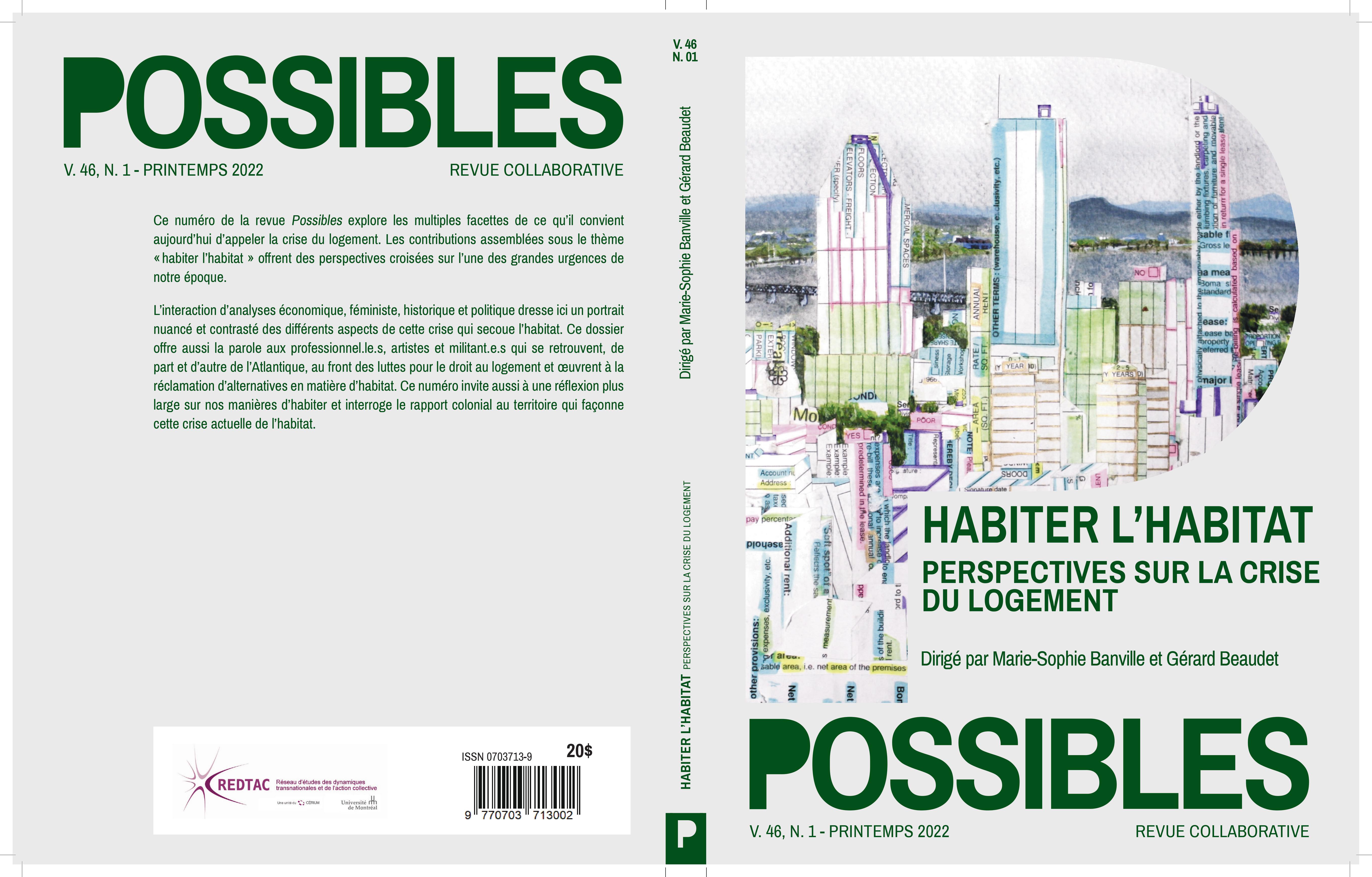Références
Alves Calio, Sonia et Iranilde José Messias Mendes. 2006. « Droit au logement : le mouvement des femmes au Brésil et l’expérience dans la favela Gamboa de Santo André, São Paolo, Brésil », dans : C. Verschuur et F. Hainard (Dir.). Des brèches dans la ville. Organisations urbaines, environnement et transformation des rapports de genre [En ligne]. Genève : Graduate Institute Publications, http://books.openedition.org/iheid/6557.
Bergeron-Gaudin, Jean-Vincent. 2017. « Les luttes relatives au logement au Québec : un portrait historique », dans : S. Paquin et J.-P. Brady (Dir.). Groupes d’intérêts et des mouvements sociaux., pp. 219-240. Québec : Presses de l’Université Laval.
Bergeron-Gaudin, Jean-Vincent, Pascale Dufour et Anne Latendresse. 2020. « Une brèche féministe dans les luttes relatives au logement : l’expérience d’Information-Ressources Femmes et Logement, 1986-1995 », Cahiers de géographie du Québec (64) : à paraître.
CÉAF (Centre d’éducation et d’action des femmes). 2016. Chaînes et résistance. Contre les violences vécues par les femmes locataires. Montréal : CÉAF.
Conseil du statut de la femme. 2019. Quelques constats sur la monoparentalité au Québec. En ligne : https://csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/constats-monoparentalite-qc.pdf (page consultée le 29 mars 2022). Montréal : Conseil du statut de la femme.
Desroches, Marie-Eve. 2018. « Le logement comme clé pour le droit à la ville des femmes », Métropoles no 22 (avril). https://doi.org/10.4000/metropoles.5577.
Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale du Montréal métropolitain (FÉCHIMM). 2018. Rapport d’évaluation des besoins. Les coopératives : présence des femmes, pouvoir des femmes. Montréal : FÉCHIMM.
Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU). 2015. « Des logements pour les femmes et les enfants ». Montréal : FRAPRU.
FRAPRU. 2010. « Femmes, logement et pauvreté : sortir du privé, un enjeu de société ». Montréal : FRAPRU.
FRAPRU. 2000a. Cahier de revendications de la MMF. Montréal : FRAPRU.
FRAPRU. 2000b. Lettre datée, 14 septembre. Montréal : FRAPRU.
FRAPRU. 2000c. « Logement au Québec : femmes et pauvreté », p. 2. Montréal : FRAPRU.
Galerand, Elsa, et Danièle Kergoat. 2014. « Les apports de la sociologie du genre à la critique du travail ». La nouvelle revue du travail no 4 (mai). https://doi.org/10.4000/nrt.1533.
Gilbert, Anne et Damaris Rose (Dir.). 1987. « Espace et femmes : pour une géographie renouvelée », Cahiers de géographie du Québec 31(83).
Giraud, Isabelle et Pascale Dufour. 2010. Dix ans de solidarité planétaire. Perspectives sociologiques sur la Marche mondiale des femmes. Montréal : Les Éditions du remue-ménage.
Goyer, Renaud. 2017. « Déménager ou rester là. » Rapports sociaux inégalitaires dans l’expérience des locataires. Thèse de doctorat. Université de Montréal.
Hélène, Diane et Kaya Lazarini. 2018. « Autonomie et émancipation : les femmes dans les mobilisations pour le droit au logement à São Paulo, Brésil. » Communication dans le cadre du colloque Perspectives féministes sur le logement des femmes, Montréal, 15-16 mai.
Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS). 2014. Tâches domestiques : encore loin d’un partage équitable. Notes socio-économique, octobre. Montréal : IRIS.
Laperrière, Marie-Neige. 2018. « Perspective féministe sur l’article 1974.1 du Code civil du Québec. Une protection efficace dans la vie des femmes locataires victimes de violences ? », Canadian Law and Society Association / Association Canadienne Droit et Société 33(1) : 41-59.
Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ). 2004. Historique des démarches et revendications politiques du Comité logement pour les droits des victimes de violence conjugale. Montréal : RCLALQ.
Rose, Damaris. 2018. « Les approches québécoises sur les femmes et le logement : recherche et activisme féministes », dans : A. Lambert, P. Dietrich-Ragon et C. Bonvalet (Dir.). Le monde privé des femmes. Genre et habitant dans la société française, pp 57-84. Paris : Éditions de l’Ined.
Silva, Joseli Maria. 2003. « Um ensaio sobre as potencialidades do uso do conceito de gênero na análise geográfica », Revista de História Regional 8(1) : 31-45.