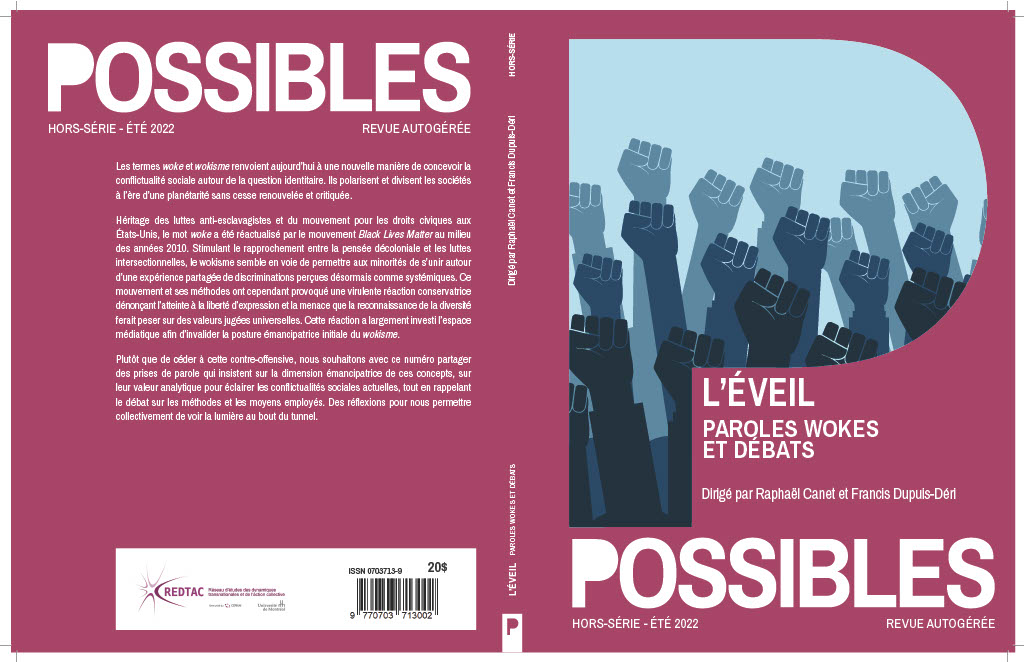Références
Antonius, Rachad. 2021. « La liberté universitaire est menacée, et pas seulement par la droite », Relations, (813) : 12. En ligne : cjf.qc.ca/revue-relations/publication/article/la-liberte-universitaire-est-menacee-et-pas-seulement-par-la-droite/ (Page consultée le 10 juillet 2022).
Antonius, Rachad. 2017. « Islamophobie : regards critiques sur l’usage du concept ». Conférence présentée au Colloque international « Interculturalité, communication et migrations transnationales », IXe Forum de Migrations, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 16-20 octobre. En ligne : classiques.uqac.ca/contemporains/antonius_rachad/Islamophobie_regards_critique/Islamophobie_regards_critique_texte.html (Page consultée le 10 juillet 2022).
Antonius, Rachad et Normand Baillargeon (Dir). 2021. Identité, « race », liberté d’expression. Perspectives critiques sur certains débats qui fracturent la gauche. Québec : Presses de l’Université Laval.
Collectif. 2021. « Rapport de la Commission sur la liberté universitaire : un cas exemplaire de panique morale », Pivot, 22 décembre. En ligne : pivot.quebec/2021/12/22/rapport-de-la-commission-sur-la-liberte-universitaire-un-cas-exemplaire-de-panique-morale/ (Page consultée le 10 juillet 2022).
Diangelo, Robin. 2020. Fragilité blanche : ce racisme que les blancs ne voient pas. Paris : Les Arènes.
Fortier, Marco. 2019. « La professeure El-Mabrouk refuse d’aller au colloque de l’Alliance », Le Devoir, 30 janvier. En ligne : ledevoir.com/societe/education/546634/la-professeure-el-mabrouk-n-ira-pas-au-colloque-de-l-alliance (Page consultée le 10 juillet 2022).
Gilbert, Anne, Maxime Prévost et Geneviève Tellier (Dir.). 2022. Libertés malmenées. Chronique d’une année trouble à l’Université d’Ottawa. Montréal : Leméac.
Guillemette, Mélissa. 2020. « Whiteness studies : ces travaux qui exposent le privilège des Blancs », Québec Science, 13 novembre. En ligne : https://www.quebecscience.qc.ca/societe/whiteness-studies/ (Page consultée le 10 juillet 2022).
Lilla, Mark. 2018. La gauche identitaire : l’Amérique en miettes. Paris : Stock.